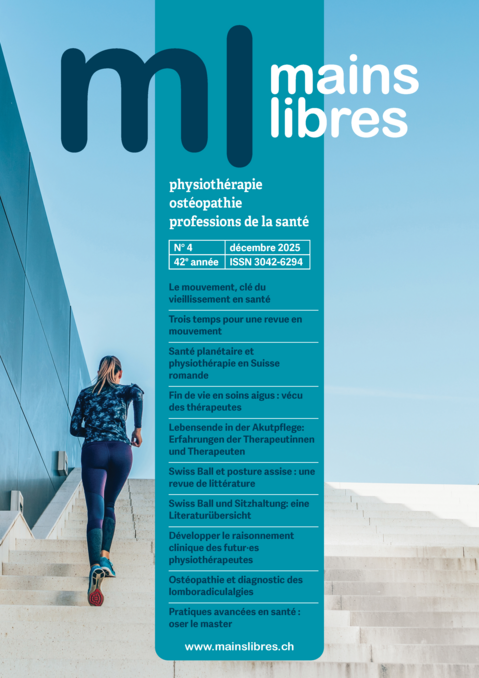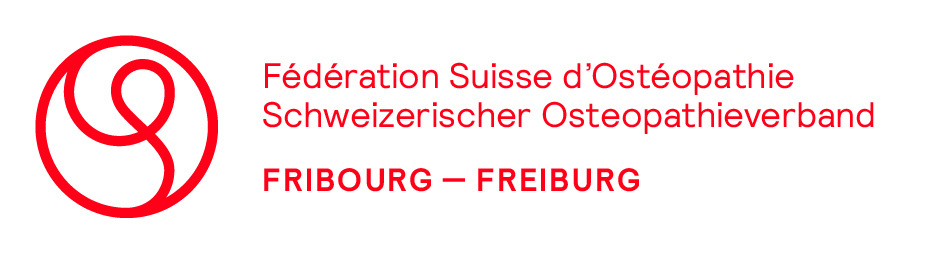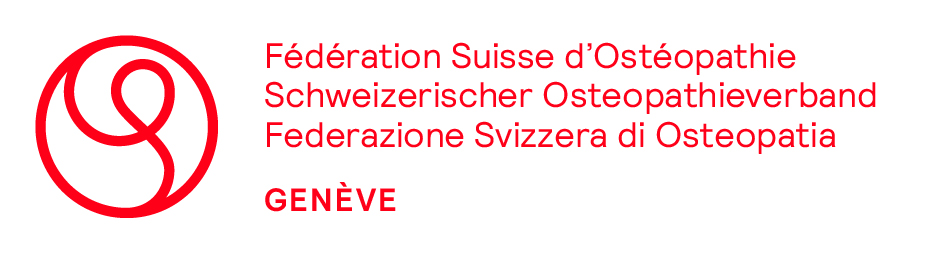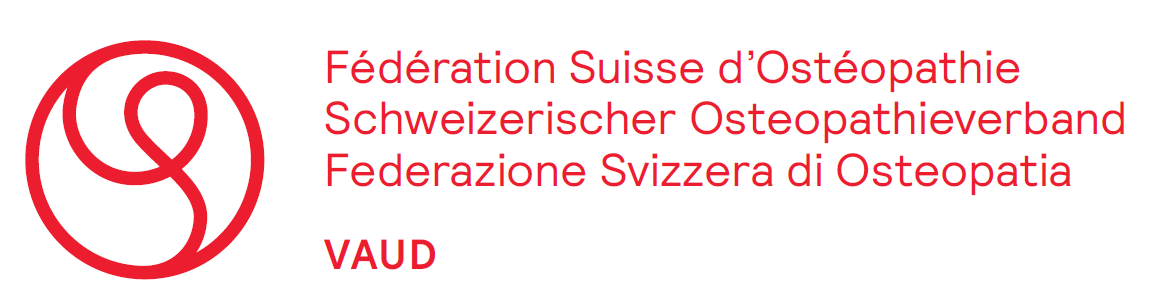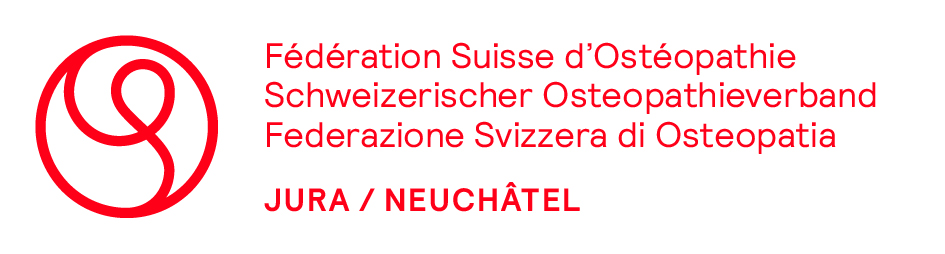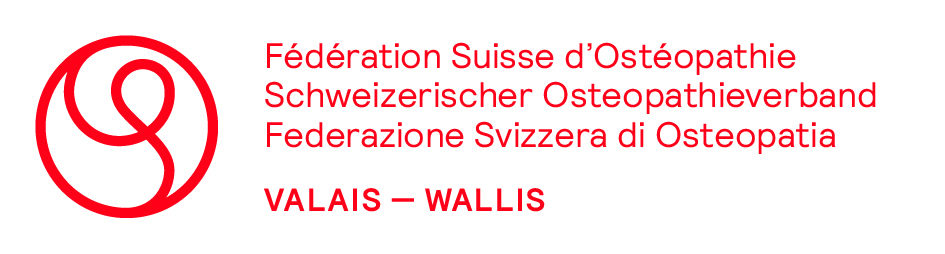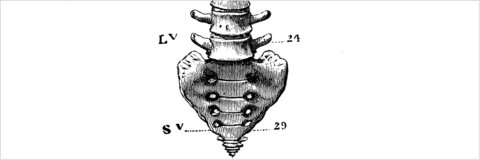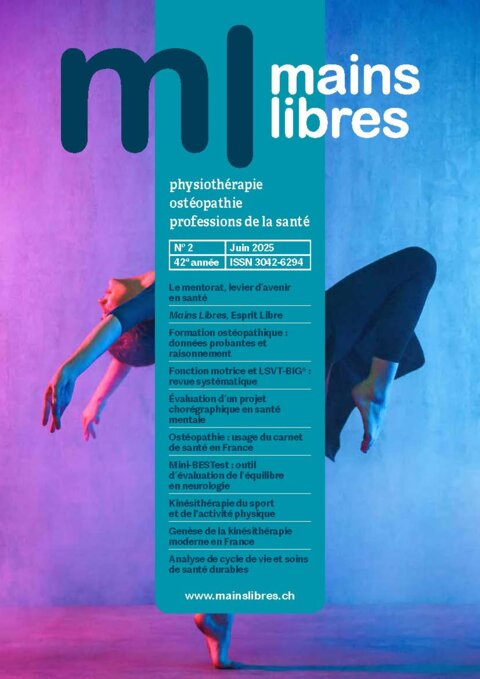Développer le raisonnement clinique pour préparer la relève de la physiothérapie à l’autonomie et à la complexité des soins : un article de synthèse
Introduction : Le raisonnement clinique (RC) constitue une compétence centrale en physiothérapie, nécessitant un enseignement structuré dès la formation initiale.